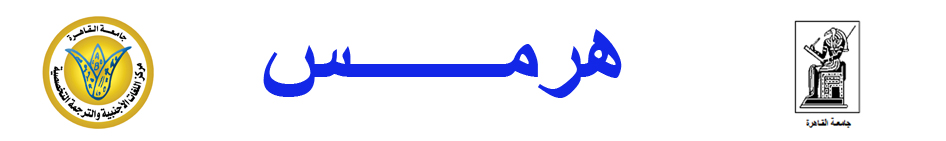
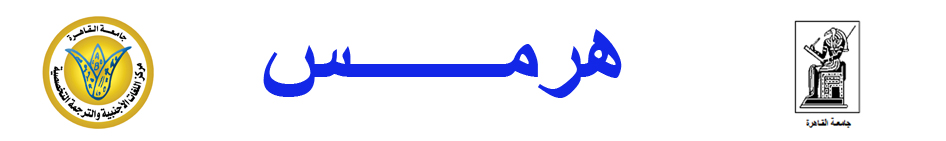
نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
Université du Caire
المستخلص
الكلمات الرئيسية
Le roman de Yasmina KHADRA, Ce que le jour doit à la nuit (2008) est caractérisé par le « retour du référent »[i], non pas pour écrire les déviations de la société algérienne après l’indépendance, ni le terrorisme qui la secoue dans les années 90, ni les malaises de l’immigration, lesquels ne sont évoqués que schématiquement dans le discours des acteurs français, à la fin du récit, mais pour écrire l’Algérie coloniale, cette empreinte ineffaçable de l’Histoire qui fonde et hante l’espace littéraire algérien. Il s’agit donc, d’un regain de réalisme, dont le socle est le chronotope de l’Histoire, privilégié par Bakhtine, celui des : « desseins les plus complexes de l’homme, des générations, des époques, des peuples, des groupes sociaux »[ii], où Histoire et histoire, destins individuels et nationaux s’enchevêtrent. Le héros Younes ou Jonas tourné vers le passé, fait le récit de sa vie. Confié par son père ruiné à son oncle marié à une Française, il fait l’expérience de l’écartèlement existentiel entre deux communautés culturelles différentes, opposées, voire antagoniques : la communauté arabe et celle des pieds-noirs . Son histoire individuelle est greffée sur l’Histoire de l’Algérie coloniale, sur l’immédiat politique des années 1930 - 1962, sur ses fractures et ses conflits.
Quel est le discours émis par ce récit colonial ? Ce travail tente de répondre à cette question en cernant les opérations en jeu dans la stratégie discursive et narrative du récit et en y examinant les rapports entre histoire et Histoire. Bénéficiant des acquis de la recherche sur le roman réaliste et la sémiotique narrative, il se constitue au confluent de plusieurs méthodes dont les principales sont : - la sémiotique du discours telle élaborée par Fontanille, lequel considère le discours comme un ensemble signifiant produit par une énonciation, où interfèrent trois modes sémiotiques, trois logiques, en l’occurrence, action, cognition, passion ; l’analyse du personnage examiné par Hamon selon deux axes préférentiels –le sexe et la territorialisation-, envsiagé dans son être, son faire, son équipement modal : le vouloir, le savoir, le pouvoir ; de même les études de Bonn et de Moura sur la littérature francophone et le postcolonialisme.
Ce récit post-colonial et cette recherche ne peuvent alors, qu’être apparentés au postcolonialisme en tant « qu’une perspective sur la littérature renvoyant aux lettres naissant dans un contexte marqué par la colonisation. « Post-colonial » désigne donc le fait d’être postérieur à la période coloniale, tandis que « postcolonial » se réfère à des pratiques de lecture et d’écriture intéressées par les phénomènes de domination, et plus particulièrement par les stratégies de mise en évidence, d’analyse et d’esquive du fonctionneement binaire des idéologies impérialistes »[iii].
Instance du discours, le héros installe sa deixis répartie en deux champs spatio-temporels : celui de l’énoncé : 1930- 1962, référant à deux dates cruciales, celles du centenaire de la colonisation, et de l’indépendance de l’Algérie-, et celui de l’énonciation -2008-, indiqué par le titre de la dernière partie du roman: « Aix-en-Provence (Aujourd’hui) ». Loin de gommer la situation d’énonciation, ce récit repose ainsi sur « La définition forte de l’espace d’énonciation »[iv] indissociable de la dynamique historique, distinguant sa scénographie laquelle « définit les statuts d’énonciateur et de coénoncateur, l’espace et le temps à partir desquels se développe l’énonciation qu’elle se suppose. La scénographie est elle-même dominée par la scène littéraire qui confère à l’œuvre son cadre pragmatique, associant une position d’auteur et une position de public, et imposant le rituel discursif propre à tel genre. Loin d’être un message contingent, la scénographie ne fait donc qu’une avec l’œuvre qu’elle soutient et qui la soutient »[v]. Tout en datant le récit, les balises temporelles inhérentes à des événements politiques relancent les séquences narratives et scandent la destinée des acteurs.
Cette scénographie se développe également à partir d’un axe fondamental, celui de l’èthos[vi], notion aristotélicienne identifiée à celle de l’énonciateur, à la voix source, garant du récit. Dans cette autobiographie fictive, Younes assume « la responsabilité historique de témoignage »[vii], à laquelle souscrit presque tout narrateur de récit colonial. Il se dresse en tant que témoin d’un passé qu’il restitue à la lumière du présent : « je suis aux portes de la mémoire (…) ces grands tiroirs obscurs où sont stockés les héros ordinaires que nous avons été (…) les acteurs et les figurants que nous fûmes tour à tour (…) ployés sous le fardeau (…) de nos certitudes et nos doutes ; bref, de nos indomptables illusions »[viii]. Cette voix est celle d’une mémoire émergeant d’une conjoncture coloniale oppressante, admettant la précarité de son existence problématique au croisement des deux espaces, ceux des colonisés et des colonisateurs, des deux temps, le passé et le présent.
Si toute Histoire coloniale est fondée sur la conquête et la domination d’un territoire envahi par une puissance étrangère, l’essence du narratif dans tout récit colonial, la programmation de ses phases, la carrière romanesque de ses acteurs, les réseaux thématiques et symboliques qui le sous-tendent, sont inextricablement liés à sa spatialité fictionnelle et à sa régie topographique.
Dans Ce que le jour doit à la nuit, le récit a pour point de départ, un drame spatial. Suite à la mise en feu de ses champs, le père de Younes est dépossédé de son lopin de terre. Si le sujet de l’agression n’est pas révélé, le bénéficiaire et son adjuvant le sont : «C’était le caïd, escorté de sa garde prétorienne (…) il somma mon père d’apposer ses empreintes digitales sur les documents qu’un français (…) vêtu de noir de la tête aux pieds, s’était empressé d’extirper de son cartable »[ix]. Cette séquence liminaire, est à plus d’un titre, significative. Tout en relançant la chaîne narrative, l’agression infligée au lieu originaire, le lieu violenté, conquis, la dépossession, s’avèrent être au plan thématique et symbolique, l’équivalent métaphorique de la violence historique qu’est la colonisation, laquelle pèse comme une fatalité sur la destinée des acteurs. En outre, la régie discursive de cette scène reposant sur la catégorie sémantique de l’opposition, se répercute sur tous les niveaux du récit.
Au niveau figuratif, la topographie est placée sous le signe de l’antonymie entre bled, village, hameau, d’un côté, ville et village colonial, de l’autre. Cette opposition se double d’une différenciation politique, sociale et économique, entre espace des colonisés et celui des colonisateurs. Les mentions négatives du premier sont diamétralement opposées aux mentions positives du second. À plusieurs reprises, le narrateur/acteur le souligne. Personnage mobile qui fréquente des lieux différents, Younes est particulièrement, attentif à l’espace social des foules. Il circonscrit ainsi, le premier cadre spatio-temporel du récit, son bled subissant inéluctablement l’indigence: « En ces années 1930, la misère et les épidémies décimaient les familles et le cheptel avec une incroyable perversité, contraignant les rescapés à l’exode, sinon à la clochardisation »[x]. De même qu’il s’étend sur la disgrâce qui frappe son village : « C’était un trou perdu, triste à crever (…) craquelé sous le poids des misères »[xi].
Arrivant à Oran pour la première fois, il est fasciné par sa beauté, son charme, et le bien-être qui y règne, mais également choqué par le gouffre qui sépare les deux espaces : « La ville ! (…) De très belles demeures s’élevaient de tous les côtés(…) Il émanait, de ces endroits privilégiés, une quiétude et un bien-être que je ne croyais pas possibles – aux antipodes du relent viciant mon bled (…) où les enclos à bestiaux étaient moins affligeants que nos taudis »[xii].
Les métaphores antithétiques : jour/nuit, vie/trépas, désignant la ville d’Oran et le maquis de Jenane Jato – deuxième station dans son itinéraire-, illustrent le contraste régissant la disposition figurative de la spatialité: « Il n’y a rien de plus grossier que les volte-face de la ville. Il suffit de faire le tour d’un pâté de maisons pour passer du jour à la nuit, de vie à trépas (…) Le « faubourg » où nous atterrîmes rompit d’un coup les charmes qui m’avaient émerveillé quelques heures plus tôt. Nous étions toujours à Oran, sauf que nous étions dans l’envers du décor. Les belles demeures et les avenues fleuries cédèrent la place à un chaos infini hérissé de bicoques sordides, de tripots nauséabonds »[xiii].
Tout comme Oran, Rio Salado, lieu de résidence définitif du héros, s’avère être un espace bipartite, auquel est adjoint, à quelques encablures, le hameau où habite le factotum Jelloul. Les topos qui correspondent respectivement à la description de ces lieux, réitèrent les ressources de l’association contrastive entre le centre et la périphérie, le confort et l’inconfort, l’aisance et la misère, la richesse et l’indigence, le bonheur et le malheur, l’euphorie et la dysphorie. Le narrateur exalte l’aspect ravissant du village colonial : « J’ai beaucoup aimé Rio Salado (…) C’était un superbe village colonial (…) Assis en tailleur au milieu de ses vignes et caves viticoles (…) Rio se laissait déguster à la manière de ses crus, guettant, entre deux vendanges, l’ivresse des lendemains qui chantent »[xiv]. Par contre, un sentiment de peur et de menace s’empare de Younes perturbé devant l’espace déprimant, répugnant, infernal et angoissant des colonisés : « La misère du douar où habitaient Jelloul et sa famille dépassait les bornes (…) Soudain j’eus peur d’être là, de l’autre côté de la colline (…) Le hameau, subitement, m’épouvantait. (…) en plus de la puanteur, il y avait le bourdonnement des mouches (…) il n’arrêtait pas d’engrosser l’air vicié d’une litanie funeste, comme un souffle diabolique planant par-dessus une détresse humaine aussi vieille que le monde et tout aussi affligeante »[xv]. Recélant un potentiel politique, la description des lieux est entraînée dans la série temporelle des événements narrés, puisqu’elle explique et préfigure l’affrontement inéluctable de l’espace des colonisés et celui des colonisateurs.
Par ailleurs, « La narrativité, comme la psychologie des personnages doit donc être pensée (…) en termes de territorialité »[xvi]. La victoire des colonisateurs français, en tant qu’intrus, est matérialisée non seulement par la conquête du monde des autochtones, mais également par l’expulsion de ces derniers dans un ailleurs répulsif, en l’occurrence, Jenane Jato, et le hameau décrits ci-dessus.
Au niveau actoriel, la relation de dominant à dominé, régit les rapports des acteurs français et algériens. Dans son chemin d’Oran à Rio Salado, Younes décrivant les colonies qui défilent devant ses yeux, ne manque pas de souligner cette relation de domination, manifestée au plan topographique, par l’axe de verticalité qui oppose le bas et le haut, par les fermes surplombant les taudis : « De superbes fermes émergeaient ça et là, le plus souvent sur un promontoire pour dominer le bled, encadrées d’arbres majestueux et de jardins»[xvii]. De même, il dresse un portrait-charge qui disqualifie Jaime Jiménez Sosa, figure-type du grand colon arrogant et impitoyable, tout en dénonçant l’exploitation inhumaine des colonisés par les colonisateurs : il « faisait la pluie et le beau temps sur son fief où il parquait comme des bêtes les innombrables familles musulmanes qui trimaient pour lui. Le casque colonial vissé au crâne, la cravache contre ses bottes d’équitation, Jaime Jiménez Sosa (…) était le premier debout et le dernier à se mettre au lit, faisant travailler ses « forçats » jusqu’à tomber dans les pommes, et malheur aux simulateurs ! »[xviii]. On retrouve le rôle-type du « bourreau victorieux non-conscient d’être oppresseur »[xix].
Également, cette relation d’opposition se reflète sur le statut modal des acteurs collectifs et individualisés. Les français sont des sujets du faire, alors que les Algériens sont des sujets selon l’être, ainsi définis par Greimas : « Le sujet du faire est celui qui, doté des modalités du faire, organise et exécute le programme narratif, tandis que le sujet selon l’être n’est que le dépositaire des propriétés (valeurs ou modalités) qui lui sont attribués, ou dont il est privé, à la suite des transformations opérées par les deux sujets antagonistes du faire »[xx]. L’espace algérien conquis, consacre le pouvoir des Français, et leur domination des colonisés. Occupé, construit et fructifié, il soutient les colons dans leur plan de domination du pays, et de subjugation des colonisés.
En fait, la mise en valeur et l’exploitation des richesses des terres conquises, s’avèrent être l’argument fondamental, la pierre angulaire du discours colonial. Bouleversé par la guerre de l’indépendance qui envahit le pays, s’adressant à Jonas, Jaime Jiménez Sosa plaide ainsi pour la colonisation et l’assujettissement de la population : « grâce à ma famille, Jonas, grâce à ses sacrifices et à sa foi, le territoire sauvage s’est laissé apprivoiser (…) s’est transformé en champs et en vergers (…) nous avons fait d’une désolation millénaire un pays magnifique, prospère et ambitieux, et d’un misérable caillou un fabuleux jardin d’Eden. Personne (…) ne pourrait nous dénier le droit de continuer de la servir jusqu’à la fin des temps »[xxi]. Ce discours fait retentir les prétentions territoriales du colonialisme reposant sur le couple antithétique civilisation/barbarie, sur la téléonomie du progrès.
Deux autres figures emblématiques de cette relation de domination, sont André Sosa, et son factotum Jelloul qu’il maltraite et brutalise[xxii]. Sujet selon l’être, Jelloul possède un savoir réfléchi sur soi-même, sur son statut d’autochtone subjugué. Fouetté et chassé par son maître, se rendant chez Younes, pour lui demander de l’argent, il lui dit : « André ne peut pas se passer de moi (…) Il ne trouvera pas meilleur chien que moi sur le marché »[xxiii]. Broyé par la misère qui le réduit à l’asservissement, il décrit ainsi sa condition : « on cesse d’être un être humain… Entre le chien et le chacal, la bête amoindrie choisit d’avoir un maître »[xxiv]. Toutefois, et en dépit de cette servitude, de cette humiliation dans lesquelles il est tenu, de ce sentiment d’infériorité, il affirme son droit sur le pays qui lui appartient et auquel il appartient : « Regarde bien ce trou perdu. C’est notre place dans ce pays, le pays de nos ancêtres »[xxv]. Stupéfié par cette conscience de soi qui fait preuve d’un esprit mûr, le narrateur l’exprime : « J’étais sidéré par la violence de ses propos. Jelloul n’avait pas vingt ans, cependant il émanait de sa personne une force secrète et une maturité qui m’impressionnaient (…) Il affichait une dignité dont je ne l’imaginais pas capable »[xxvi]. On retrouve la figure-type de la victime consciente d’être opprimée. Sujet selon le non-pouvoir, il niera ce statut en se transformant en sujet pragmatique, en rejoignant le Front de libération national.
Inhérent à cette relation de domination, le racisme en est la configuration thématique au niveau axiologique. Le discours racial disséminé dans les propos des colonisateurs, tout au long du récit, dévalorise et la colonisation et ses sujets. Dès l’école, le système d’enseignement l’inculque. Non seulement, l’instituteur exerce des sévices sur Abdelkader qui n’a pas fait son devoir, mais, en plus, ce dernier devient la risée de sa classe : « Parce que les Arabes sont des paresseux »[xxvii]. À son cousin qui lui demande de ménager un peu Jelloul qu’il rudoie, André répond : « Les Arabes sont comme les poulpes ; il faut les battre pour les détendre »[xxviii]. Les révolutionnaires qui luttent contre la colonisation, et qui réclament l’indépendance de leur pays, sont, selon Jaime J. Sosa des « pouilleux de fainéants »[xxix]. Et à Jonas, il affirme : « J’emploie des Arabes depuis des générations (…) C’est tous des serpents »[xxx]. Selon lui, « Les fellagas ne sont pas bâtisseurs. On leur confierait le paradis, ils le réduiraient en ruines. Ils n’apporteront à ton peuple que malheurs et désillusions »[xxxi].
De ce racisme qui sévit dans cet espace manichéen où s’exacerbent les contraires, découle le schéma narratif de l’épreuve défini par la concurrence de deux programmes narratifs[xxxii] : le maintien de la colonisation, et la lutte pour l’indépendance, lesquels confrontent sujets collectifs - Algériens colonisés et Français colonisateurs-, et sujets individualisés : les militants nationalistes -Jelloul, Ouari-, le colon Jaime J. Sosa, le militant de l’OAS Jean-Christophe, le harki Krimo. Cet antagonisme qui se déploie vers la fin du récit, se résout par la victoire des colonisés. La disposition binaire de l’espace recèle en son sein les germes de son effondrement ; c’est au moment où le pouvoir des colonisateurs sur l’espace atteint son apogée, que l’autochtone, le colonisé exclu, du fait de son exclusion raciale et déshumanisante resurgit pour détruire tout l’édifice colonial et affirmer ses droits sur l’espace reconquis.
En rupture avec ce parcours antagonique, le héros ne quitte pas son statut de témoin, sémiotiquement parlant, en tant que sujet de l’énoncé, de la perception proprioceptive, dont la position du corps, articule l’univers extéroceptif, la perception du monde extérieur, à l’univers intéroceptif, la perception du monde intérieur, en d’autres termes, le sensible et l’intelligible[xxxiii]. C’est ainsi qu’il affirme: « Je ne suis qu’un regard qui court, court, court à travers le blanc de l’absence et la nudité des silences »[xxxiv]
Détaché de l’action, il joue un rôle épisodique lorsque la guerre de l’indépendance se déclare. À Jelloul qui lui demande de choisir son camp, il répond: « Je n’aime pas la guerre »[xxxv]. Lorsqu’il l’accuse d’être un lâche et lui crie : « N’as-tu pas compris que tout un peuple se bat pour ta propre rédemption »[xxxvi], sa réponse laisse sous-entendre qu’il refuse de prendre part à l’humiliation infligée aux adversaires : « N’est-ce pas l’humiliation qui t’a contraint à porter les armes ? Pourquoi l’exerces-tu à ton tour aujourd’hui ? »[xxxvii]. Il est, en quelque sorte forcé de collaborer avec les combattants. Il leur fournit des provisions de médicaments, de matériel de soin et d’auscultation. Il agit, sans vraiment assumer son action. Plutôt qu’une action voulue et maitrisée, il s’agit d’une action consentante et subie. Tout en reconnaissant la nécessité de cette guerre, la légitimité de sa cause – à son ami André, il dit : « c’était prévisible, Dédé. Il y avait un peuple couché par terre, sur lequel on marchait comme sur une pelouse. Il fallait un jour ou l’autre qu’il se remue »[xxxviii]-, il ne peut se résoudre à admettre ses abominations : « Puis je rencontrai la guerre…la guerre grande nature ; le succube de la mort ; l’autre réalité que je ne voulais pas regarder en face »[xxxix]. D’ailleurs, le portrait disqualifié d’Ouari[xl], l’ami d’enfance à Jenane Jato, qui est devenu l’insaisissable baroudeur Sy Rachid, révèle l’attitude distante du narrateur/acteur vis-à-vis des sujets de cette guerre: « C’était Ouari (…) qui m’avait appris l’art du camouflage et la chasse aux chardonnerets, à Jenane Jato. Il avait vieilli avant l’âge, mais le regard demeurait intact : sombre, métallique, impénétrable (…) il eut un réflexe d’autodéfense, me saisit par la gorge et m’attira violemment vers lui »[xli].
À l’encontre du schéma narratif de l’épreuve, celui du héros est la quête : « Il s’agit de la définition des valeurs, qui vont donner son sens au parcours du Sujet »[xlii]. La quête d’identité est en fait, une autre facette de cette scénographie coloniale. C’est elle qui fonde le récit autobiographique, motive ce retour sur soi et sur le passé. Essayant de faire le bilan de sa vie, le narrateur/acteur l’explicite, à la fin du récit : « comment se reconnaître au milieu de tant d’ombres (…) Qui sommes-nous au juste ? Ce que nous avons été ou bien ce que nous aurions aimé être ? Le tort que nous avons causé ou bien celui que nous avons subi ? Les rendez-vous que nous avons ratés ou les rencontres fortuites qui ont dévié notre destin ? »[xliii]. L’identité comme valeur axiologique, finalise le parcours narratif du héros qui se révèle être principalement un sujet passionnel, et cognitif. Sujet d’énonciation, centre de perspective et témoin, son discours révèle les modulations de son état : états d’âme et états du corps sensible, ainsi que son évolution en tant que sujet de quête, évoquant et évaluant des faits et des objets cognitifs.
Si l’affirmation de l’identité est tributaire de l’appartenance à un territoire matriciel de cette identité, la crise qui affecte Younes, résulte de sa rupture avec son espace d’origine, et les figures symboliques qui lui sont immanentes.
C’est avec regret et amertume que la mère de Younes évoque le lieu natal : « Au début, nous étions presque riches (…) Notre maison était en dur, et nous avions des jardins autour (…) Puis Dieu a décidé que l’hiver se substitue au printemps, et nos jardins ont dépéri. C’est la vie, mon enfant »[xliv].
À Rio Salado, auprès des champs, foyer de pulsion centripète, le narrateur se sent dans son milieu naturel ; ce cadre spatial lui rappelant son village natal le ravit: « Je me sentis dans mon élément (…) Né au cœur des champs, je retrouvais un à un mes repères d’antan, l’odeur des labours et le silence des tertres. Je renaissais dans ma peau de paysan, heureux de constater que mes habits de citadin n’avaient pas dénaturé mon âme. (…) J’ai aimé Roi Salado. C’était un pays de grâce »[xlv]. Ce village colonial, telle une éclaircie le confirme donc, dans son identité, suscite la nostalgie de l’espace d’origine.
Le portrait de Lalla Fatna, esquissé par l’oncle, renseigne sur le passé glorieux des ancêtres, tout en renvoyant à celui du pays : « C’était une sorte de douairière, aussi autoritaire que fortunée. Elle s’appelait Lalla Fatna, et avait des terres aussi vastes qu’un pays (…) les notables de la région venaient laper dans le creux de sa main. Même les officiers français la courtisaient (…) Cette dame, cette figure de légende, eh bien, c’est ton arrière- grand-mère »[xlvi].
La pièce maîtresse dans ce puzzle d’identité, est l’Algérie, qui prédomine dans le discours des nationalistes algériens reçus par son oncle, laquelle s’identifie avec l’espace des colonisés, ployant sous l’asservissement et le dénuement : « Ils parlaient tous d’un pays qui s’appelait l’Algérie ; pas celui que l’on enseignait à l’école ni celui des quartiers huppés, mais d’un autre pays spolié, assujetti, muselé et qui ruminait ses colères comme un aliment avarié- l’Algérie de Jenane Jato, des fractures ouvertes et des terres brûlées, des souffre-douleur et des portefaix… un pays qu’il restait à redéfinir et où tous les paradoxes du monde semblaient avoir choisi de vivre en rentiers »[xlvii].
Tout comme le pays, lequel est incarné par le portrait effacé, toutefois saillant de la sœur devenue sourde-muette après le drame de la dépossession, les acteurs qui assurent l’identité, sont ruinés, déchus, réduits au silence. Certes, la figure principale est le père ainsi décrit par le narrateur: « mon père n’avait d’yeux que pour ses terres. Ce n’était qu’à cet endroit, au milieu de son univers blond, qu’il était dans son élément. Rien ni personne, pas mêmes ses êtres les plus chers, n’étaient en mesure de l’en distraire »[xlviii].
Outre ce statut d’autochtone, le portrait valorisé du père fait ressortir son orgueil, sa fierté, son indépendance, son entêtement à se redresser seul, soulignés plusieurs fois, par le narrateur : « Entre mon père et moi, tout était une question d’honneur ; Et l’honneur ne se mesurait qu’en fonction de notre aptitude à surmonter les épreuves »[xlix].
Cependant, le destin narratif du père est jalonné d’échecs et de déceptions successifs. À l’instar du pays, il remâche sa rage indiquée à plusieurs reprises. Suite à l’incendie criminelle, il « continua d’asperger les volutes de fumée qu’exhalaient les touffes calcinées. Il ne restait plus rien des champs et pourtant il s’entêtait à ne pas le reconnaître. Par dépit »[l]. Lorsque son frère lui demande de lui confier son fils, « Il était à deux doigts d’imploser (…) son silence en ébullition ajoutait à son allure une tension qui me (le narrateur) faisait craindre le pire »[li]. Enfin, ses économies volées, « Il se démaillait fibre par fibre (…) ruminant en silence son fiel et son dépit »[lii]. C’est ce dernier coup qui l’amène à s’amputer de son fils, à le céder à son frère ; sur ce, il succombe à une dégradation progressive, dont le point d’aboutissement est la déchéance totale : « Le mendiant renifla le parterre (…) Mon père… qui était capable de soulever les montagnes (…) Il était là à mes pieds, sur le trottoir, dans des guêtres malodorantes, le visage tuméfié, les commissures des lèvres dégoulinantes de bave (…) Une épave… une loque… une tragédie ! »[liii]. Perdant la face devant son fils, le père ne parvient pas à surmonter cette honte, cette humiliation : « Il disait qu’on pouvait perdre sa fortune, ses terres et ses amis, ses chances et ses repères, il demeurait toujours une possibilité, aussi infime soit-elle, de se reconstruire quelque part ; en revanche, si on venait à perdre la face, il ne serait plus nécessaire de chercher à sauver le reste »[liv]. Le père sombre ainsi dans l’extinction existentielle et textuelle.
Ce déracinement, cette amputation et de l’espace d’origine et des êtres qui en participent, affligent le héros. Ses champs ravagés, il décrit ainsi l’impact de cet événement sur lui et sur sa famille. « C’était fini. Je me souviendrai toute ma vie de ce jour qui vit mon père passer de l’autre côté du miroir (…) j’avais le sentiment de me dissoudre dans un clair-obscur (…) où l’univers battait en retraite pour nous isoler dans notre détresse »[lv]. L’image du père honni ne le quittera jamais : « J’aimais trop mon père pour l’imaginer à mes pieds fagoté tel un épouvantail (…) Alors, il me jeta ce regard qui me poursuivra ma vie entière ; ce regard déchu (…) Je compris qu’il me le destinait pour la dernière fois ; que ces yeux, qui m’avaient couvé (…) ne se lèveraient jamais plus sur moi »[lvi]. Le père déchu est longtemps quêté. Le regret nostalgique du père en fait un fantôme obsédant : « Mais j’ai revu plusieurs fois mon père (…) C’était parce qu’il portait le même paletot vert, qui échappait à l’usure du temps (…) que j’avais fini par comprendre qu’il n’était pas de chair et de sang. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, à mon âge finissant, il m’arrive encore de l’entrevoir au loin, le dos voûté (…) clopinant lentement vers son propre effacement »[lvii].
Quant à la mère, le héros en dresse un portrait qui insiste sur son charme, sa distinction, et sa dignité : « Elle était belle, ma mère (…) Elle avait de l’allure, de la grâce »[lviii]. Tout comme le père, la mère ne sort pas indemne de ce déracinement ; elle s’enlise dans la misère. Le dernier portrait esquissé par le fils accuse sa dégradation : « J’avais honte de sa fébrilité (…) honte de la famine et des affres qui la défiguraient, elle qui fut belle comme le lever du jour »[lix].
Ce n’est qu’en vieillissant que le narrateur reconnaît les séquelles de cette amputation, de ce déchirement familial : « À mon âge, je ne me rendais pas compte des dégâts que mon départ infligeait aux miens, de la mutilation que j’étais devenu »[lx].
Cette crise d’identité est due également au statut de l’acteur déclassé, « en instance de transfert social entre des lieux différenciés »[lxi]. Elle est balisée par la ruine de l’espace d’origine, celui de ses parents et ancêtres, et par son installation chez son oncle, son déplacement vers un espace d’accueil. La carrière romanesque du héros est alors scandée par cette disjonction, cette rupture avec l’espace familial, l’espace de l’ici : « Ce n’est pas bon pour toi, ici »[lxii], lui dit sa mère- et son intrusion dans un espace étranger, différencié, l’espace de l’ailleurs- « j’étais déjà ailleurs »[lxiii], affirme t-il. Le gouffre qui sépare les deux espaces est immense, que la stupéfaction s’empare de Younes pénétrant dans la maison de son oncle : « Je pensai à mon père, à notre gourbi sur nos terres perdues, à notre trou à rats de Jenane Jato ; l’écart me parut si grand que j’en eus le vertige (…) je découvrais, ébahi, les choses des temps modernes »[lxiv]. Le glissement du Moi vers l’Autre passe par le biais du nom- Younes/Jonas- et du code vestimentaire- déshabillage/rhabillage – lequel redouble le processus culturel de déculturation et d’acculturation- : « Une fois rhabillé, elle me présenta devant une grande glace ; j’étais devenu quelqu’un d’autre »[lxv].
Toutefois, cette altérité de surface ne modifie en rien son statut d’intrus toléré dans l’espace des colonisés: « À l’école (…) les petits roumis étaient des enfants étranges (… )Je n’étais pas tout à fait un des leurs et ils ne manquaient aucune occasion de me le rappeler »[lxvi].
Écartelé entre deux espaces, il se montre incapable de déterminer celui auquel il appartient. À Fabrice lui reprochant de ne pas réagir aux propos racistes d’André : « je m’attendais à ce que tu le remettes à sa place »[lxvii], il répond : « Il y est déjà Fabrice. C’est moi qui ignore où est la mienne »[lxviii]. Fuyant en hâte l’espace des colonisés, Jelloul lui rappelle que leur espace est également le sien, l’accusant implicitement de se désolidariser d’eux, de ne pas partager leur sort, de ne pas prendre en compte le changement de la situation politique : « C’est comme ça que vivent les nôtres Jonas. Les nôtres qui sont aussi les tiens. Sauf qu’ils n’évoluent pas là où tu te la coules douce (…) Tourne le dos à la vérité des tiens et cours rejoindre tes amis…Younes…J’espère que tu te souviens encore de ton nom »[lxix]. Younes en fait, reconnaît le bien-fondé de ces paroles : « Jelloul n’avait pas tort (…) Partagé entre la fidélité à mes amis et la solidarité avec les miens, je temporisais. Il était évident qu’après (…) la prise de conscience des masses musulmanes, je serais contraint d’opter, tôt ou tard, pour un camp »[lxx]. Ce tiraillement le travaille lorsqu’André bat Jelloul, figure de bouc émissaire, l’accusant à tort de tuer son cousin : « je rentrai chez moi, écartelé entre la colère et l’indignation, honteux et avili, doublement meurtri et par la mort de José et par le martyre de Jelloul »[lxxi].
C’est le discours véhément de Jaime J. Sosa sur le colonialisme raciste, qui décide Younes à prendre position: « Ces terres ne sont pas les leurs (…) nous ne céderons pas. L’Algérie est notre invention (…) et nous ne laisserons aucune main impure souiller nos graines et nos récoltes »[lxxii]. Face au colon qui refuse d’admettre que l’Algérie n’appartient pas aux colonisateurs, mais aux colonisés, Younes exaspéré, plaide pour la cause nationale, le droit incontestable de l’autochtone sur son lieu d’origine : « Il y a très longtemps, monsieur Sosa (…) un homme se tenait à l’endroit où vous êtes. Lorsqu’il levait les yeux sur cette plaine, il ne pouvait s’empêcher de s’identifier à elle (…) Cet homme était confiant (…) libre (…) jusqu’au jour où (…) il vit arriver le tourment. On lui confisqua (…) ses terres et ses troupeaux (…) Et aujourd’hui, on veut lui faire croire qu’il était dans les parages par hasard (…) Cette terre ne vous appartient pas. Elle est le bien de ce berger d’autrefois dont le fantôme se tient juste à côté de vous et que vous refusez de voir (…) Le malheur y sévit depuis que vous avez réduit des hommes libres au rang de bêtes de somme »[lxxiii]. C’est ainsi que le héros passe du stade du savoir à celui du croire ; cette transition va de pair avec une prise de conscience plénière de son identité. Non seulement, il met en relation des objets cognitifs parallèles et contrastés, des espaces opposés : - identification de l’acteur autochtone et de son espace d’origine ; espace identitaire non-colonisé vs espace colonisé ; liberté, sérénité vs asservissement, malheur-, mais il évalue, assume son jugement et prend position[lxxiv].
Cette quête cognitive de l’identité est indissociable du parcours affectif du héros, axé sur deux configurations passionnelles : l’amour et l’amitié. Trois aventures amoureuses jalonnent l’itinéraire sexuel du héros. La première à l’âge de treize ans, ne fait que ressortir le racisme de la communauté française, que confirmer le narrateur/acteur dans son statut d’intrus rejeté, ou de colonisé inclus, demeurant inférieur. L’accusant d’être un menteur, de lui cacher son vrai nom, Younes demande à Isabelle : « - Tout le monde m’appelle Jonas. Qu’est-ce que ça change ? (…) Son visage congestionné frétillait de dépit : - Ça change tout ! (…) Nous ne sommes pas du même monde, monsieur Younes. (…) Tu m’imagines mariée à un Arabe ? … Plutôt crever ! »[lxxv]. Et le narrateur, éveillé durement à la réalité occultée par la naïveté de l’enfance, décrit ainsi ses sentiments et l’impact de cette expérience douloureuse qui entérine son altérité radicale et inférieure, tout comme les colonisés: « J’étais choqué (…) Désormais, je n’allais plus percevoir les choses de la même façon (…) Adam éjecté de son paradis n’aurait pas été aussi dépaysé que moi (…) À partir de ce rappel à l’ordre, je me mis à faire plus attention où je mettais les pieds. Je remarquai surtout (…) que les loques enturbannées, qui galéraient dans les vergers des aurores à la tombée de la nuit, n’osaient même pas s’approcher de la périphérie d’un Rio jalousement colonial »[lxxvi]. Le lieu interdit aux colonisés se fait l’écho de la belle colonisatrice répudiant impitoyablement Younes.
La deuxième à dix-sept ans, aura une influence décisive sur sa destinée. Dès qu’il l’a vue, Jonas a eu le coup de foudre pour Mme Cazenave, respectable mère de famille : « Raffinée, le port noble, elle ne marchait pas ; elle cadençait la foulée du temps. J’étais hypnotisé »[lxxvii]. Justement, Jonas subit le charme de cette femme décrite comme instigatrice de l’érotisme : « j’étais comme un chardonneret pris au piège (…) j’avais la tête dans un nuage, les pieds sur un tapis volant. Effrayé par tant de bonheur, peut-être avais-je tenté de me soustraire à son emprise, car sa main me retint très fort par la nuque. Alors, je me laissai faire. Sans opposer la moindre résistance»[lxxviii]. L’action se passe sans qu’il l’assume. Plutôt que sujet agissant, il est sujet pâtissant. Cette dynamique sexuelle reposant sur la relation actif/passif, est inscrite dans une dynamique plus globale, celle du conflit politique et de l’Histoire, laquelle reflète les rapports de force entre colonisateurs et colonisés. L’isotopie de la séduction est embrayée sur celle de la conquête. Le texte le laisse sous-entendre : « Sa bouche revint plus rassurée, plus conquérante (…) Ravi d’être pris au piège, fébrile et consentant, et, émerveillé par ma capitulation »[lxxix]. La séduction de Jonas par Mme Cazenave est la métaphore de la conquête historique subie et du pouvoir instauré. Cette relation de domination est d’autant plus corroborée, lorsque voulant prendre l’initiative, Younes est repoussé définitivement[lxxx].
Cette intrigue décide du sort de cette passion qui ensuite, s’empare de Younes corps et âme. Sans s’expliquer, il repousse Émilie, la fille de Mme Cazenave, en dépit de l’amour authentique, profond qu’il éprouve pour elle et qu’elle voue pour lui. Mme Cazenave, tourmentée par sa foi religieuse, terrifiée d’être damnée pour l’inceste, prie Jonas de ne pas s’approcher de sa fille : « L’histoire de ma fille et de vous ne doit pas avoir lieu (…) Ce serait horrible, amoral, incroyablement obscène, totalement inadmissible »[lxxxi]. De son côté, Younes tenaillé par sa conscience morale, soliloque : « Quel serait cet amour qui s’érigerait sur le sacrilège, sans noblesse et sans bénédiction ?»[lxxxii]. L’union illégitime, immorale, souille toute union légitime et morale possible. En dépit des supplications répétées d’Émilie : « Vous ne pouvez pas mesurer (…) combien j’ai honte de me dénuder devant vous, d’insister de me battre pour un sentiment qui ne vous frappe pas de plein fouet pendant qu’il m’anéantit (…) je vous aime toutes les fois que je respire »[lxxxiii], Younes ne fléchit pas tout en étant torturé par cet amour fou qui l’obsède et qui le possède: « Je souffrais (…) je m’apercevais qu’Émilie prenait possession de mes préoccupations (...) La nuit, je ne pouvais m’endormir sans passer en revue ses gestes et ses silences. Le jour (…) je me surprenais à languir d’elle(…) À quoi servirait l’amour (…) s’il devait s’assujettir aux interdits (…) Et le chagrin d’Émilie me paraissait pire que toutes les abjurations, toutes les profanations, et tous les blasphèmes réunis »[lxxxiv]. Cette impuissance à échanger l’amour ne fait que confirmer le narrateur dans son rôle de témoin réduit à l’inaction. La liaison scandaleuse avec la mère condamne préalablement cet amour. Le passé pèse sur le présent et lui barre l’avenir. Cette histoire d’amour avortée est alors l’équivalent métaphorique de cette situation historique sans issue, de cette impasse où se tiennent colonisés et colonisateurs ; la conquête illégale ne peut déboucher sur un partenariat légal et moral. En fait, ces deux acteurs, la mère et la fille, représentent les deux facettes contrastées et indissociables de la France, l’État conquérant et le pays humaniste.
Cet itinéraire sexuel ne fait qu’attester l’intrication des deux isotopies : historico-politique et pathémique, celles des conflits historico-politiques et des conflits privés. Surtout que, cette intrigue amoureuse décide du sort de ses amitiés. La belle Émilie est convoitée par ses trois amis. Flirtant avec Fabrice, puis avec Jean-Christophe – lequel, surprenant son aveu d’amour à Jonas, se sent trahi et rompt totalement avec lui -, et enfin épousant Simon, elle sème brouille et mésentente au sein de cette bande. La dissension amicale reflète, résonne avec les conflits politiques qui opposent et séparent les amis ; la guerre de l’indépendance déclarée, Jean Christophe rejoint l’OAS, Simon est assassiné, Jonas s’en solidarise tout en y participant marginalement.
La fuite, la solitude et l’isolement auxquels il est contraint, déclenchent un retour sur soi, sur son identité, d’autant plus catalysé par son errance dans un espace identitaire : Médine J’dida, dont la « topographie discriminante »[lxxxv] distingue l’espace autochtone de la culture dominante : « Un monde était en train de se reconstruire dans son authenticité séculaire (…) Médine J’dida (…) musulmane et arabo-berbère jusqu’au bout des ongles (…) Comment avais-je pu me passer de cette partie de moi-même ? J’aurais dû venir régulièrement par ici (…) forger mes certitudes (…) Je me rendis compte que je m’étais menti sur toute la ligne. Qui avais-je été à Rio ? Jonas ou Younes ? (…) Pourquoi avais-je constamment l’impression de me tailler une place parmi mes amis (…) Avais-je été (…) apprivoisé ? Qu’est-ce qui m’empêchait d’être pleinement moi, d’incarner le monde dans lequel j’évoluais, de m’identifier à lui tandis que je tournais le dos aux miens ? (…) J’étais une ombre indécise (…) À qui la faute si Émilie m’avait échappé des mains ? (…) Tout compte fait, je crois que mon tort était de n’avoir pas eu le courage de mes convictions »[lxxxvi]. Faisant le bilan de sa vie, reconnaissant l’atteinte portée à son identité, il assume la responsabilité de son échec au plan affectif et axiologique. Cette conscience de soi se confirme par son inhérence à la conscience de groupe, laquelle s’aiguise par cette déambulation, sa dilution dans l’espace social identitaire, et par sa fréquentation des foules : « À mon insu, je me surprenais (…), à errer dans les quartiers musulmans d’Oran, à m’attabler avec des gens que je ne connaissais pas et dont la proximité désenclavait mes solitudes. Me revoici à Médine J’dida (…) m’instruisant auprès d’un jeune imam d’une érudition étourdissante, écoutant les yaouled déguenillés commenter la guerre en train de dépecer le pays (…) Je me mis à retenir des noms jusque-là inconnus (…) Ben M’hidi, Zabana, Boudiaf (…) noms de héros et noms de lieux indissociables d’une adhésion populaire que j’étais à mille lieues d’imaginer aussi concrète, aussi déterminée »[lxxxvii]. À l’opposé du colon qui veut réduire l’Algérie aux colonies qu’il a établies, l’errance du héros insiste sur la spécificité de l’espace algérien, sur son identité arabo-berbère. En fait, ces séquences où la déambulation du héros s’avère être un prétexte narratif à la description, prolongent une autre située au début du récit, avant le déplacement de l’acteur vers son espace d’accueil, et portant sur le jour de souk et les festivités qui l’aaccompagnent : les spectacles présentés par les gouals, les charmeurs de serpents, les charlatans, les illuminés, les Karcabo[lxxxviii]. La description de ces traditions n’est pas gratuite ; celles-ci confèrent à la culture algérienne son originalité, sa singularité, bref, son identité, à l’encontre du discours colonialiste qui la nie.
Cette identité rétablie et confirmée parallèlement à l’émergence de l’Algérie algérienne, ne se départit pas de la compassion pour les colonisateurs exclus, de l’apitoiement sur le sort des partants: « C’était un beau jour (le 4 juillet 1962), avec un soleil grand comme la douleur des partants, immense comme la joie des rentrants »[lxxxix]. Les séquences contrastées, lesquelles closent le champ temporel de l’énoncé, décrivant les colonisés se réappropriant leur espace, et les colonisateurs expulsés, l’illustrent : « J’avais marché dans les rues en liesse, au milieu des chants et des youyous (…) Demain, le 5 juillet, l’Algérie aurait une carte d’identité (…) Sur les balcons, les femmes laissaient éclater et leur joie et leur sanglots (…) J’étais allé au port pour voir partir les bannis (…) Des paquebots attendaient de lever l’ancre, vacillant sous le chagrin des expatriés »[xc].
C’est ainsi que les deux parcours cognitif et passionnel se croisent, illustrant l’écartèlement du héros, non seulement entre deux identités, mais également, entre la quête de l’identité d’un côté, et celle de l’amour et de l’amitié, de l’autre. L’obsession du père, figure-type de l’identité, laquelle a pour contrepartie l’errance, puis l’interminable quête pour retrouver la bien-aimée, l’amour, le révèle.
C’est l’histoire du sujet subissant l’Histoire, vivant en parallèle deux espaces antagoniques, tiraillé entre raison et passion, lesquelles partagent indissociablement et irrémédiablement son être. Au terme de cette quête d’identité, le narrateur affirme : « Nous sommes tout cela en même temps, toute la vie qui a été la nôtre, avec ses hauts et ses bas, ses prouesses et ses vicissitudes ; nous sommes aussi l’ensemble des fantômes qui nous hantent… nous sommes plusieurs personnages en un, si convaincants dans les différents rôles que nous avons assumés qu’il nous est impossible de savoir lequel nous avons été vraiment, lequel nous sommes devenus, lequel nous survivra »[xci]. C’est peut-être, cette ambiguïté, concept préconisé par Bonn[xcii] pour l’étude du récit colonial, qui greffe le destin narratif de Younes de tragique.
Par ailleurs, cette écriture de l’Algérie coloniale, ne fonctionne que dans le cadre d’une entreprise d’écriture du présent : « La scénographie postcoloniale inscrit donc souvent l’œuvre dans le retour et le cheminement retrospectif, non par nostalgie ou regret, mais (...) pour expliquer, voire orienter une situation actuelle et problématique. L’histoire intervient comme une donnée positive, dynamisante, de la construction de la temporalité énonciative »[xciii]. Ce récit serait-il alors, une réponse à la loi promulguée le 23 février 2005, supprimée par la suite, à cause des violentes réactions diplomatiques, laquelle demandait aux programmes scolaires de mettre l’accent sur le rôle civilisateur de la colonisation française en Afrique du Nord ?
Toutefois, ce discours polémique se double d’un autre, conciliant. C’est ce que la scénographie du récit reflète en mettant en scène les deux champs temporels de l’énonciation et de l’énoncé. Si le champ de l’énoncé se clôt sur la dissension et la séparation, celui de l’énonciation se clôt sur les retrouvailles. Si la concorde s’avérait être impossible au passé, vu l’impact de la colonisation et ses présupposés : oppression, racisme, assujettissement, vu les effets de la guerre de l’indépendance, elle devrait être au présent, le choix « des gens sensés, qui finissent obligatoirement par se réconcilier »[xciv]. Le récit emprunte alors, le schéma de la décadence où la détente cognitive suit la tension affective : « toute crise doit se résoudre sur le modèle du schéma descendant, grâce à des arrangements cognitifs, des compromis raisonnables (…) et parfois même présentés d’une manière laborieusement explicative (…) les relations entre les protagonistes se réorganisent, et la situation se stabilise »[xcv].
C’est ce que Younes et Jean-Christophe ont fait : « Semblables à deux rivières qui déferlent des antipodes, charriant toutes les émotions de la terre, et qui, après avoir bousculé monts et vallées, fusionnent soudain dans un même lit au milieu d’écume et de trombes »[xcvi]. Cette fusion des deux anciens amis brouillés, métaphore du discours conciliant préconisé entre ex-colonisés et ex-colonisateurs, entre État conquérant et État conquis, est certes, le message délivré par le récit. En fait, cette morale de l’histoire, ne peut qu’être embrayée sur le nom du héros Younes lequel, signifiant en arabe colombe, symbolise la paix ; ainsi que sur le récit biblique et coranique du prophète Jonas/ Younes, prônant le pardon et la justice comme valeurs salutaires. Toutefois, c’est l’intégration, l’assomption du passé, en l’occurrence, le récit, ou l’histoire de l’Histoire, et non pas son déni ni son occultation, qui constituent la condition sine qua non des retrouvailles et des accords possibles. C’est ce que le jour doit à la nuit, c’est ce que le présent doit au passé.
C’est en ce sens que ce récit s’inscrit dans le cadre de la pensée postcoloniale, celle qui « insiste sur l’humanité-à-venir, celle qui doit naître une fois que les figures coloniales de l’inhumain et la différence raciale auront été abolies. Cette espérance dans l’avènement d’une communauté universelle et fraternelle »[xcvii].
Notes
[i]- BONN Charles, « La littérature maghrébine de langue française », Littérature maghrébine [En ligne], article sur Limag.com, 1996. .
[ii] - BAKHTINE Mikhaïl, Esthétique de la création verbale, Paris, Éditions Gallimard, 1984, p. 232.
[iii][iii] - MOURA Jean-Marc, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, PUF, 1999, pp. 10-11.
[iv] - Ibid, p. 141.
[v] - Ibid, pp. 121-122.
[vi] - Voir ibid, pp. 134-139.
[vii] - BONN Charles, op.cit.
[viii] - KHADRA Yasmina, Ce que le jour doit à la nuit, Paris, Julliard, 2008, p. 405.
[ix] - Ibid. p. 17.
[x] - Ibid, p. 12.
[xi] - Ibid, p. 14.
[xii] - Ibid, p. 24.
[xiii] - Ibid, pp. 27-28.
[xiv] - Ibid, pp. 121-122.
[xv] - Ibid, pp. 187-188.
[xvi] - HAMON Philippe, Le personnel du roman. Le système des personnages dans les Rougon-Macquart d’Émile Zola, Genève, Librairie Droz S.A., 1983, p. 229.
[xvii] - KHADRA Yasmina, op. cit. p. 118.
[xviii] - Ibid, p. 144.
[xix] - HAMON Philippe, op. cit, p. 309.
[xxi] - KHADRA Yasmina, op. cit. pp. 303-305.
[xxii] - Voir, ibid, pp. 145; 185.
[xxiii] - Ibid, p. 186.
[xxiv] - Ibid.
[xxv] - Ibid, p. 189.
[xxvi] - Ibid, pp. 186-187.
[xxvii] - Ibid, pp. 93-94.
[xxviii] - Ibid, p. 145.
[xxix] - Ibid, p. 305.
[xxx] - Ibid, p. 301.
[xxxi] - Ibid, p. 307.
[xxxii] - Voir, FONTANILLE Jacques, Sémiotique du discours, Limoges, PULIM, 1998, p. 110.
[xxxiii] - Voir, ibid, p. 35.
[xxxiv] - KHADRA Yasmina, op. cit. p. 408.
[xxxv] - Ibid, p. 337.
[xxxvi] - Ibid, pp. 342-343.
[xxxvii] - Ibid, p. 343.
[xxxviii] - Ibid, p. 356.
[xxxix] - Ibid, p. 317.
[xl] - Voir, ibid, p. 58.
[xli] - Ibid, p. 341.
[xlii] - FONTANILLE Jacques, op. cit. p. 112.
[xliii] - KHADRA Yasmina, op. cit. p. 406.
[xliv] - Ibid, p. 88.
[xlv] - Ibid, p. 123.
[xlvi] - Ibid, p. 79.
[xlvii] - Ibid, p. 92.
[xlviii] - Ibid, pp. 12-13.
[xlix] - Ibid, p. 55.
[l] - Ibid, p. 16.
[li] - Ibid, p. 42.
[lii] - Ibid, p. 68.
[liii] - Ibid, pp. 95-96.
[liv] - Ibid, p. 106.
[lv] - Ibid, p. 18.
[lvi] - Ibid, p. 97.
[lvii] - Ibid, p. 163.
[lviii] - Ibid, p. 87.
[lix] - Ibid, p. 139.
[lx] - Ibid, p. 89.
[lxi] - HAMON Philippe, op. cit, p. 215.
[lxii] - KHADRA Yasmina, op. cit. p. 88.
[lxiii] - Ibid.
[lxiv] - Ibid, p. 75.
[lxv] - Ibid, p. 74.
[lxvi] - Ibid, pp. 92-93.
[lxvii] - Ibid, p. 146.
[lxviii] - Ibid.
[lxix] - Ibid, pp. 188-189.
[lxx] - Ibid, p. 189.
[lxxi] - Ibid, p. 298.
[lxxii] - Ibid, p. 305.
[lxxiii] - Ibid, pp. 306-307.
[lxxiv] - Voir, FONTANILLE Jacques, op. cit, pp. 222-223.
[lxxv] - KHADRA Yasmina, op. cit, pp. 128-129.
[lxxvi] - Ibid, p. 129.
[lxxvii] - Ibid, p. 169.
[lxxviii] - Ibid, p. 175.
[lxxix] - Ibid.
[lxxx] - Voir Ibid, p. 180.
[lxxxi] - Ibid, p. 234.
[lxxxii] - Ibid, p. 265.
[lxxxiii] - Ibid, p. 275.
[lxxxiv] - Ibid, pp. 263-264.
[lxxxv] - MOURA Jean-Marc, op. cit, p.142.
[lxxxvi] - KHADRA Yasmina, op. cit, pp. 283-284.
[lxxxvii] - Ibid, p. 315.
[lxxxviii] - Voir, ibid, pp. 50-53.
[lxxxix] - Ibid, p. 366.
[xc] - Ibid, p. 370.
[xci] - Ibid, p. 406.
[xcii] - Voir, BONN Charles, «Scénographie postcoloniale et ambiguïté tragique dans la littérature algérienne de langue française, ou pour en finir avec un discours binaire », Littérature maghrébine [En ligne], article sur Limag.com,2006. .
[xciii] - MOURA Jean-Marc, op. cit, pp. 147-148.
[xciv] - KHADRA Yasmina, op. cit, p. 407.
[xcv] - FONTANILLE Jacques, op. cit, p. 107.
[xcvi] - KHADRA Yasmina, op. cit,, p. 411.
[xcvii] - MBEMBE Achille, « Qu’est-ce que la pensée postcoloniale », 2006, [ En ligne],article sur http://www,esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=13807, p. 118.